Je ne me considère pas du tout comme un spécialiste, ni un expert, des questions culturelles ; mais mon champ de recherche fait que c’est un des thèmes sur lesquels je travaille en tant qu’historien et sociologue de l’immigration… On pourra y revenir, d’ailleurs, puisque c’est un des enjeux d’aujourd’hui. Tu [Alain Hayot] parlais tout à l’heure de l’islam, on voit bien que les questions de l’immigration sont aussi évidemment des questions culturelles. Ce n’est pas non plus en tant que professionnel de la culture que j’interviens. Je n’ai jamais eu de responsabilité dans ce domaine-là. J’interviens dans ces domaines-là en tant qu’ « intellectuel spécifique » pour reprendre une formule de Michel Foucault, que je développe dans le petit livre qui s’appelle Dire la vérité au pouvoir, Les intellectuels en question [éditions Agone, collection « Éléments », octobre 2010, 312 pages, 12 €]. Parce que, pour ma part, disons que dès le début de mes études, période où j’ai commencé à militer à l’UEC et puis du PCF, j’ai été concerné par les questions culturelles à partir d’une interrogation sur la dimension civique de mon métier. Je me suis rendu compte très vite que ce n’était pas forcément une préoccupation qui était partagée par la majorité de mes collègues. Mais elle était extrêmement importante pour moi pour des raisons personnelles et je voyais avec angoisse, se développer la crise de la démocratisation du monde universitaire, illustrée par le repli dans la tour d’ivoire, la reproduction du milieu des élites, etc. C’est à partir de là que mes interrogations sur la culture sont venues. Je pense que la dimension civique de la science pose aux chercheurs le problème de leur rapport à la culture. Etant donné que la plupart d’rentre eux sont fonctionnaires, payés avec l’argent des citoyens, ils doivent nécessairement rendre des comptes sur leurs activités. Et à partir de là on a un fil conducteur qui permet de réfléchir sur le rapport entre la science et la démocratie.
J’ai été engagé depuis le début de ma carrière, dans des actions relevant de ce qu’on appelle « l’action culturelle », mais j‘ai toujours privilégié l’action « par en bas »… Encore maintenant, d’ailleurs, je m’occupe d’une petite association, j’essaie de faire des petites choses, mais à la base, comme on dit, parce que c’est là que je me sens le plus à l’aise par rapport à tout cela. Notre génération a eu la chance de pouvoir bénéficier des passerelles entre milieux sociaux construites par les partis politiques – en l’occurrence le Parti communiste… Moi j’ai été formé par le biais de La Nouvelle critique… Ces liaisons permettaient à chacun de sortir de son petit univers, de voir les connexions qui peuvent exister entre les problèmes des uns et des autres. Aujourd’hui je suis vraiment affolé de voir que nous sommes confrontés, tous, à une même politique, très agressive, de remise en cause de la Fonction publique, des missions de services publics… comme on dit…, mais que les gens se battent les uns après les autres, sans coordonner leur action. Connaissant assez bien le milieu du théâtre, j’ai vu les luttes des intermittents menées d’un côté, et puis après les chercheurs se sont engagés dans leur propre combat. Je crois que la réflexion collective doit nous amener à retrouver le moyen d’actions en commun et de s’interroger sur les raisons pour lesquelles elles ne se font pas.
Je voudrais maintenant dire quelques mots sur l’expérience que j’ai accumulée au cours de toutes ces années d’action culturelle, sans trop les détailler.
Ça a été, donc, la participation à la radio libre de la CGT Lorraine Cœur d’Acier, au tout début des années 1980. J’ai cotoyé à ce moment-là Marcel Trillat qui est esté un ami très proche, qui a joué un rôle extraordinaire dans cette expérience. A l’époque, j’étais enseignant dans un collège de la banlieu de Longwy à ce moment-là, au moment des grandes luttes de la sidérurgie… Ma vocation de conjuguer à la fois les enjeux de vérité et les enjeux militants, s’est noué à ce moment-là, autour de cette radio où je faisais les émissions d’histoire. Premier moment.
Deuxième moment : le combat – qui a duré plus de vingt ans – pour la mise en place d’un lieu de mémoire dédié à l’immigration. Puisque j’ai créé la première association pour un musée de l’immigration, avec Zaïr Kédadouche, en 1989, l’année du bicentenaire de la Révolution française, donc juste après l’ouvrage que j’ai écrit, qui s’appelle Le creuset français [Le creuset français, Histoire de l’immigration, XIXe-XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1988 ; édition revue et augmentée en 2006 dans la collection « Points Histoire » chez le même éditeur, 448 pages, 9 €] qui est considéré comme le premier ouvrage sur l’histoire de l’immigration en France… malheureusement, la gauche qui était au pouvoir à l’époque n’a pas su saisir l’occasion. Et ce projet s’est concrétisé plus de vingt ans après, puisque c’est seulement en 2006 que la Cité nationale d’histoire de l’immigration (CNHI) a été créée grâce, sous la présidence de Jacques Chirac, et en grande partie grâce à Jacques Toubon – ce qui n’était pas spécialement mon bord politique ! Donc j’ai été dans le conseil scientifique de la Cité. On a eu des réflexions très intéressantes sur ce qu’on pouvait faire concrètement pour lier, trouver des connexions entre le monde des historiens, les artistes, les militants associatifs, etc. ça a débouché sur un certain nombre de choses ; je pourrai en reparler tout à l’heure, mais, bon, il se trouve qu’avec sept de mes collègues j’ai démissionné du conseil scientifique lorsque Nicolas Sarkozy a créé le ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale [« ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire » ; le portail Internet actif aujourd’hui est sous l’onglet du « ministère de l’Intérieur, de l’Outre mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration » titré : « L’immigration, l’intégration, l’asile et le développement solidaire »]. La création de ce ministère était contradictoire avec les objectifs civiques fixés par la CNHI. Nous avons donc assumé nos responsabilités en démissionnant. Mais je dirai qu’il y a eu là aussi, une capitalisation d’expériences et puis la conviction qu’il y avait des choses qui pouvaient se faire, même si les circonstances politiques ne le permettaient plus. J’ai créé ensuite l’association DAJA, qui fonctionne en réseau plus que comme un collectif et qui rassemble des chercheurs, des artistes, des militants associatifs, autour de projets communs. Et là c’est aussi une expérience très intéressante que je mène depuis maintenant depuis deux ou trois ans, avec des projets comme par exemple la conférence théâtrale sur le clown « Chocolat », qu’on tourne depuis deux ans maintenant pratiquement dans toute la France, et qui nous montre, sur le terrain, les contradictions qui peuvent exister. Par exemple, entre les maisons de la culture, les théâtres de centre ville, les associations… la frustration qu’on peut entendre dans le milieu associatif. C’est ce qui m’a déterminé à m’engager plus directement sur ces questions et aussi à développer une réflexion pour essayer de penser la situation avec les outils que nous offrent, finalement, les sciences sociales.
Voilà la démarche dans laquelle je suis, et dont j’ai commencé à rendre compte dans un autre petit livre publié chez le même éditeur (Agone), qui s’appelle Histoire, théâtre & politique [Histoire, Théâtre, & Politique, Paris, éditions Agone, collection « Contre-feux », 190 pages, 15 €, 2009], que je considère comme un travail très modeste puisque je ne me considère pas comme un spécialiste. Mais je pense, malgré tout, qu’il y a nécessité aujourd’hui de poser un certain nombre d’instruments ; de s’appuyer sur les recherches. On a de plus en plus de recherches aujourd’hui en sociologie qui concernent ces questions-là; qui nous permettent donc d’aborder des réalités qui sont peut-être difficiles, conflictuelles, avec une certaine distance critique pour que ça n’apparaisse pas comme des formes de dénonciation des personnes. Parce que ça, c’est extrêmement important. Si on veut réer les conditions d’un véritable débat, il ne faut pas que les gens soient mis en position d’accusés. Sinon on tombe dans des logiques de justification, et à partir de ce moment-là chacun défend ce qu’il fait, ce qu’il est, ce qu’il a été, Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui pour pouvoir avoir ce type de d’échange. Les univers professionnels sont tellement séparés qu’il n’y a pratiquement pas d’échange. Donc, on a d’un côté des chercheurs qui peuvent faire des études très intéressantes, mais qui sont le plus souvent méconnues des professionnels… Et inversement, donc, des universitaires qui font des recherches dans leur tour d’ivoire sans connaître les problèmes concrets que peuvent vivre les professionnels.
Je voudrais, rapidement, dire quelques mots, dans un deuxième temps, sur ce qu’on pourrait appeler l’évolution des politiques culturelles. Vincent Dubois a écrit un bouquin sur la genèse des politiques culturelles… [Vincent Dubois, La politique culturelle, Genèse d’une catégorie d’intervention publique, Paris, éditions Belin, 382 pages, 22,50 €, 2000], où il dit que l’adjectif « culturel » a été lancé en fait dans le vocabulaire français, dans l’entre-deux guerres, par des intellectuels marxistes… C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que cette politique qu’on peutt faire remonter à Romain Rolland et au théâtre populaire, a vu le jour. La nécessité de l’intervention de l’État dans les questions culturelles a été justifiée par deux exigences démocratiques
La première, c’est la « liberté du créateur », comme on dit. (Plutôt que de liberté, je préfère parler d’autonomie). L’État est garant de la liberté de création, comme il est garant de la liberté des chercheurs… Il y a d’ailleurs un fort parallélisme entre l’art et la science à ce niveau-là… Garant de la liberté, ça veut dire protection par rapport aux deux types de pouvoir qui existent dans nos sociétés : le pouvoir politique, évidemment, mais aussi le pouvoir du marché, le pouvoir économique… …
Et puis l’autre dimension de la démocratie culturelle, c’est la lutte contre les inégalités.
Les deux dimensions ont été développées avec des succès inégaux depuis les années [19]50. On peut dire que, globalement, l’autonomie de la création a été mieux défendue… que la lutte contre les inégalités sociales. Mais ce qu’ont montré la plupart des travaux sociologiques qui ont été fait là-dessus – c’est une sorte de loi qu’on rencontre, d’ailleurs, bien dans d’autres domaines que la culture – c’est que la logique de l’autonomisation pousse à la professionnalisation et à la formation d’un milieu social qui, finalement, se coupe des profanes. C’est d’ailleurs la même chose dans le monde scientifique. Donc l’État, en favorisant l’autonomie des professionnels, a favorisé la constitution de ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle « un champ » ; un univers autonome de gens qui ont leurs propres normes, leurs propres motifs de disputes internes, et qui, progressivement, peuvent arriver à se passer du public parce qu’ils bénéficient des subventions des pouvoirs publics. C’est exactement la même chose que ce qui se passe dans le monde scientifique. Un savant, un mathématicien, ne dépend pas évidemment du grand public. Il dépend uniquement de ce qu’on appelle « le jugement des pairs ». Le problème est donc de savoir si ce parallélisme, est fondé. Est-ce que le monde de l’art doit fonctionner de la même manière que le monde de la science ? Est-ce que le principe de compétence est légitime quand on sait le rôle que joue l’émotion dans l’art ? Je ne développe pas ce problème. Je me contente de le poser.
La plupart des études sociologiques sur la culture convergent pour souligner ce processus de séparation des milieux. C’est pour cela que je suis revenu beaucoup sur Brecht dans mon petit livre sur le théâtre, parce que Brecht ayant vécu et inventé son théâtre à une époque qui a précédé l’institutionnalisation de la culture pouvait combiner la science, l’art, l’action politique, etc. Alors qu’aujourd’hui c’est de plus en plus difficile objectivement parce que les milieux sont institutionnalisés, séparés, financés par des organismes différents. L’idéal de rassemblement des différents milieux – qui était celui de Jean Vilar – a été battu en brèche, pour des raisons objectives qu’il n’appartient à personne de rayer d’un coup de baguette magique, mais qu’on ne peut pas refouler – comme on le fait trop souvent.
Evidemment, il y a un lien avec la question des inégalités. Le combat pour la démocratie culturelle a suivi deux grandes voies. La première étant de rendre accessible aux milieux défavorisés, la culture légitime. Vilar [Jean] disait que [« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité. »]. La seconde voie a consisté ( surtout après mai 68) à promouvoir les cultures dominées pour les rendre légitimes. Ce sont deux dimensions qui ne sont pas évidentes à articuler et qui reflètent deux conceptions différentes de la lutte contre les inégalités. Je pense pour ma part que la culture doit favoriser l’émancipation individuelle. C’est-à-dire qu’en gros, ce que j’essaie de faire, c’est de contribuer à donner le maximum de ressources aux citoyens, à tous les citoyens, pour qu’ils aient davantage de choix. Parce que, finalement, le privilège des bourgeois, c’est d’avoir toujours le choix ! C’est surtout ça, le privilège ! Pour concrétiser ce que je veux dire, à partir questions de l’immigration, j’évoquerai les enjeux de mon livre – Le creuset français. Il a été perçu dans le public, notamment par les journalistes, comme une sorte d’appel au multiculturalisme, etc., etc. Alors que pour moi il s’agissait simplement de donner des possibilités aux citoyens de valoriser, de se rattacher ou de s’identifier à des aspects de la mémoire collective qui étaient refoulés et qui le sont encore en partie aujourd’hui, que ce soit évidemment l’héritage colonial ou d’autres formes d’immigration, etc. Et… Mais ce n’était pas pour promouvoir telle ou telle culture ou telle ou telle origine, parce qu’on peut facilement retomber dans l’identitaire en exaltant le minoritaire !
Il faut donc donner la possibilité à tous les citoyens de choisir leurs affiliations en connaissance de cause. Quand j’ai fait ma thèse j’ai fait énormément d’histoire de vies. On a même créé une association pour la sauvegarde de la mémoire collective dans le bassin de Longwy. J’ai travaillé énormément sur des gens de deuxième génération – il se trouve que c’était des Italiens, des Polonais, des Algériens… ils avaient 60 ans quand on les a interviewés. Ils n’étaient pas tous soucieux de se rattacher à un passé d’Italiens, etc. la plupart se définissaient même comme « sidérurgistes lorrains ». L’historien n’a pas à pratiquer une sorte de dictature de la mémoire, à obliger les gens à se raccrocher à tel ou tel aspect de leur passé. J’en ai tiré des leçons plus larges sur le rapport qu’on pouvait avoir à la culture, quand on se réclame de la démocratie. Pour moi, le but est de fournir des outils aux citoyens plutôt que de promouvoir telle ou telle formes culturelles. Et donc ça nécessite de trouver des de transmettre le savoir qu’on a soi-même produit, dans des formes adéquates à tous les publics.
J’ai tardivement pris conscience d’un autre problème, très compliqué : après plus de vingt ans de conférences tous azimuts contre le racisme, etc., je me suis rendu compte des limites de la formule pédagogique. Notre déformation professionnelle en tant qu’enseignant chercheur, nous pousse à croire que tout passe par la pédagogie. Mon énorme admiration pour Brecht tient au fait qu’il a montré dans sa dramaturgie qu’il avait une intelligence émotionnelle, et qu’on pouvait transmettre la connaissance du monde social en passant par de la mise en scène, par du symbolique, etc. D’où l’intérêt d’un travail en commun, entre des artistes et des chercheurs. Sans oublier aussi que nous avons tous des choses à apprendre ! Pour ma part, je dirai que c’est grâce à mon investissement dans les pratiques associatives d’éducation populaire, que j’ai pu avancer dans mes recherches sur l’immigration. Ça circule évidemment dans les deux sens.
Je voudrais maintenant faire le lien avec la politique. Je pense que l’un des axes forts de la politique de la droite, de la politique sarkozyste, c’est justement la manipulation des identités. J’ai fait une petite analyse, pour un livre qui s’appelle À quoi sert « l’identité nationale » ? [À quoi sert « l’identité nationale,Paris, éditions Agone, collection « Passé & Présent »,156 pages, 12 €, 2007], des discours de Nicolas Sarkozy quand il était candidat à la présidentielle] en 2007 ; et on voit très bien la place prise dans ses discours par toute la question de la repentance, par exemple… l’exaltation du « nous » français, etc. … c’est de l’identitaire. Et là on est dans une constante : quand on fait l’histoire du nationalisme, on s’aperçoit qu’il y a toujours des formes de manipulation identitaire. Quand Brecht parlait de la théâtralisation du fascisme, il évoquait une réalité qui est toujours la nôtre, même si, évidemment les formes politiques sont différentes, avec des médias différents. Il faudrait aussi être capable, je crois, de décortiquer ces analyses-là pour proposer des formes d’intervention nouvelles, parce qu’on a l’impression que la gauche est assez paralysée autour des thématiques du multiculturalisme, de ce qu’on appelle les cultures postcoloniales, etc., Identités qui sont elles aussi problématiques parce qu’elles peuvent enfermer les individus dans un « nous », rendant plus difficiles le processus d’émancipation que j’évoquais plus haut.
Donc… ces questions-là sont compliquées, parce que, évidemment – et je terminerai par là – elles nous amènent à poser le débat, non seulement sur le plan politique, mais aussi en termes sociologiques. Il y a aussi des acteurs sociaux, des milieux sociaux qui ont des intérêts, qui ont des représentations, et avec lesquels, il faut aussi débattre ; ce qui n’est pas toujours facile.
J’ai ce type de discussions depuis très longtemps avec les associations porteuses des cultures d’immigration. Je pense qu’on ne peut pas confondre histoire et mémoire, par exemple. Et donc là, ça rend les choses plus compliquées, parce qu’on peut être dans des positions d’alliance, de proximité, assumer soi-même des positions militantes sur le plan mémoriel et défendre dans le même temps une démarche scientifique qui critique la mémoire. On peut donc être soi-même traversé par une sorte de clivage interne entre une posture de chercheur et une posture de militant… Je crois qu’il est important, de poser concrètement tous ces problèmes et de trouver des moyens de le faire de façon à ce que tout le monde puisse exprimer y compris ses ressentiments ou ses frustrations dans ces questions culturelles.
Et là, la sociologie nous donne des armes, notamment dans l’analyse de ce qu’on appelle les porte-parole. J’ai vu depuis très longtemps des écarts, parfois énormes, entre les responsables des associations qui, disons, étaient parfaitement au courant des manières de faire pour obtenir des subventions, etc., et qui parfois pouvaient contribuer à renforcer ce que j’appelle l’ethnicisation de la société française, alors même que les gens au nom desquels ils parlaient étaient dans des logiques parfois très différentes et avaient plutôt… je ne dis pas que c’est systématique, mais je dis que ça existe… plutôt des identités personnelles qui les portaient plutôt à valoriser leur identité de classe. ces questions-là, c’est évidemment compliqué. Le chercheur n’est pas forcément quelqu’un qui a vocation à devenir populaire. Ca nous met dans des situations difficiles. Et c’est pour cela que depuis très longtemps, j’aspire à trouver des espaces de débat où l’on pourrait dire : voilà, on aborde ce problème de façon critique, mais ce n’est pas pour remettre en cause votre rôle. Nous avons tous nos contradictions, nos intérêts à défendre, etc. Mais cet exercice de lucidité peut nous permettre d’avancer collectivement.
Je pense que le moment est venu de faire un bilan d’un demi-siècle d’effort pour la culture publique. Parce que, si nous ne le faisons pas, eh bien évidemment c’est ceux d’en face qui le feront à notre place pour des buts et des objectifs qui sont radicalement à l’opposé de ce que nous défendons.
Telles sont les raisons qui m’ont incité à intervenir dans le débat sur « la culture pour chacun ». Le rapport du ministère sur ce sujet a suscité un véritable tollé chez les professionnels parce qu’il met en cause la « culture élitaire ». Mais quand il parle de l’intimidation sociale qu’exerce la culture légitime, il énonce un constat sociologique mainte fois établi. Beaucoup de citoyens milieux populaires n’osent pas, aujourd’hui encore, franchir les portes d’un CDN [Centre dramatique national], ou d’une Maison de la Culture. Mais dans ce rapport officiel, on prend prétexte de ce clivage de classe pour fusiller la culture publique. Donc il y a un danger. Je pense que la meilleure réponse consisterait à prendre les devants, en s’appuyant sur ces études sociologiques pour défendre autrement la culture publique. On ne peut pas se contenter de dénoncer le « populisme ». Je dirai que le populisme se développe quand les représentations populaires ne sont plus adéquates ou quand il y a un fossé qui s’est creusé entre les élites et le peuple.
le 07 mai 2011
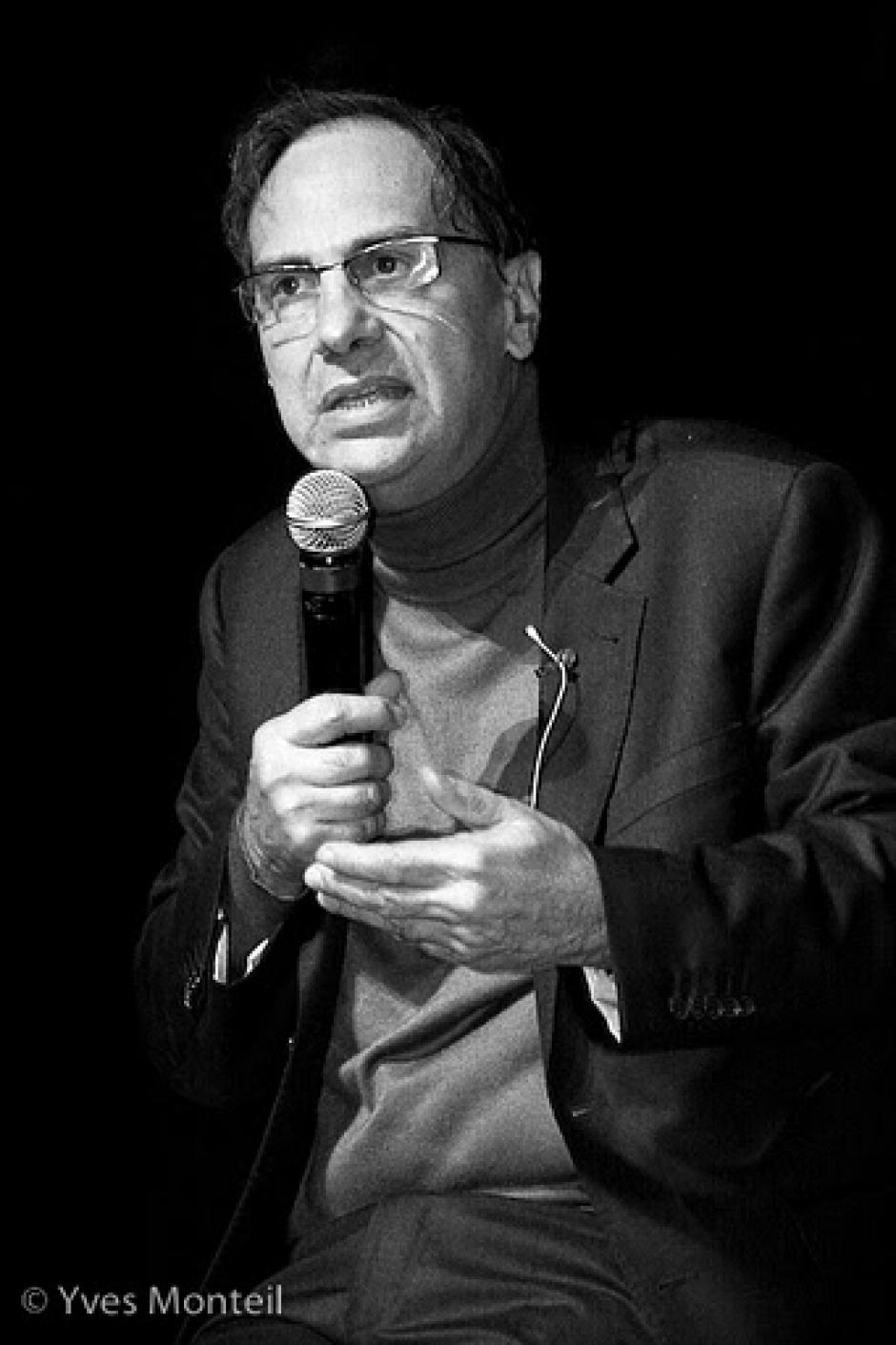
Né le 11 juillet 1950 à Nancy1, Gérard Noiriel est un historien français, l'un des pionniers de l'histoire de l'immigration en France2. Il s'est également intéressé à l'histoire de la classe ouvrière, et aux questions interdisciplinaires3 et épistémologiques en histoire. Issu d’un milieu modeste, il est aujourd'hui directeur d’études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Ses travaux eux-mêmes font le lien entre histoire et sociologie. Ils portent notamment sur les ouvriers, l’immigration, les intellectuels et l’épistémologie de la discipline historique, et plus récemment l’histoire de la maltraitance. Par ailleurs militant du droit d'asile11, il se prononce pour l'autonomie de la recherche vis-à-vis des considérations politiques conjoncturelles : pour lui, le chercheur et le citoyen ne doivent pas répondre aux même préoccupations12. Le chercheur s'interroge, explique, et enrichit la réflexion du citoyen, mais ne se questionne pas sous l'angle de, ni ne dit, ce que devrait être la politique menée en différents domaines. Pour lui, si les intellectuels peuvent parfaitement intervenir dans le débat public, ils doivent en revanche prendre garde à expliciter ce qui relève du discours scientifique et ce qui relève du discours militant 13. Il reste ainsi très critique vis-à-vis du rôle que jouent les experts dans les médias14, ainsi qu'envers l'instrumentalisation politique des faits historiques (il est notamment président du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire).
Gérard Noiriel a également été membre du conseil scientifique de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, avant d'en démissionner en mai 2007 avec 7 autres universitaires, pour protester contre la création par Nicolas Sarkozy d'un ministère associant la question de l'immigration et de l'identité nationale10. Peu après sa démission, il fait paraître un essai, À quoi sert l'« identité nationale » (Agone, 2007).
(Source Wikipédia)